Dans Pariscope, voici ce qui était indiqué au sujet de l'exposition "Mannequin, le corps de la mode" qui se tient jusqu'au 19 mai au Docks, à la cité de la mode et du design (quartier Austerlitz): "Du mannequin anonyme à la cover-girl, du porte-manteau au sex-symbol, du top model à la girl next door, ces stéréotypes interrogent la valeur marchande, esthétique et humaine du mannequin"
L'exposition commençait très judicieusement par un extrait d'un dictionnaire relatif au mot "mannequin" et où il était fait référence aux différents sens du mot, dans l'ordre de leur apparition:
1° Forme humaine sur laquelle les
couturières essaient les vêtements en cours de confection ou qui sert à
exposer ceux-ci dans les étalages
2° Dans une maison de couture, personne
sur laquelle le couturier essaie ses modèles et qui est chargée de
présenter sur elle-même les modèles de collection au public.
3° Personne sans volonté, qu'on fait mouvoir à sa guise
Et effectivement toute l'exposition sera axée sur cette évolution du terme avec, au tout départ ces fameuses formes en osier censée représenter le corps féminin. "Censées" car déjà l'on hésitait entre le corps réel et le corps tel que déformé (plus que façonné) par le port du corset.
Très vite sont apparues les catalogues de vente par correspondance (voir le succès de celui de Manufrance) de vêtements, d'abord avec des dessins, puis dès 1875 avec des photos de femmes en chair et en os. Les mannequins sont alors les couturières et les
vendeuses qui portent les vêtements des maisons pour lesquelles elles
travaillent. Pas de séduction dans ces clichés dont la tête est cachée voire déchirée. Il faut dire qu'à l'époque les mannequins sont mal perçus car les clients [au sein des maisons de couture] peuvent toucher le tissu mais aussi le corps du
mannequin dont certains considèrent qu'il s'agit d'un corps à disposition... à vendre...
Les choses changent au XXème siècle avec l'apparition des mannequins professionnels surtout lorsque, en 1924, le couturier Jean Patou fait venir à Paris des mannequins
américaines "grandes, minces, sans hanches et aux chevilles fines" définissant alors pour quelques décennies ce que seront les normes de la beauté féminine.
Nouvelle évolution dans les années 60 avec la mise en place du culte de la jeunesse qui fait recourir à des mannequins de plus en plus jeunes, dont certaines peuvent être complètement asexués à l'image de la maigrichonne Twiggy qu'un petit film nous montre faisant du patin à roulettes sur le parvis du Trocadéro.

 Mais après 1968 on assiste à l'apparition de la femme triomphante (qui sera bientôt connue par son seul prénom: Claudia, Naomi...) telle que Helmut Newton a pu la représenter avec 2 photos emblématiques intitulées "Sie kommen". Oui, "elles arrivent" habillées puis nues. C'est d'ailleurs cette version qui est la plus connue. Il est passionnant de la voir grandeur nature car on s'aperçoit alors un petit détail qu'on ne verra plus jamais sur les photos actuelles (tellement retouchées que les mannequins en perdent presque toute réalité) le duvet qui court sur les jambes et les bras d'un des mannequin au premier plan de la photo. Helmut Newton devait pressentir cette évolution lui qui, dès 1981 faisait poser le mannequin Violetta Sanchez couchée,
dans une boite en carton avec un peu plus loin son double fabriqué en plastique. Qui est la vraie, qui est la fausse.
Mais après 1968 on assiste à l'apparition de la femme triomphante (qui sera bientôt connue par son seul prénom: Claudia, Naomi...) telle que Helmut Newton a pu la représenter avec 2 photos emblématiques intitulées "Sie kommen". Oui, "elles arrivent" habillées puis nues. C'est d'ailleurs cette version qui est la plus connue. Il est passionnant de la voir grandeur nature car on s'aperçoit alors un petit détail qu'on ne verra plus jamais sur les photos actuelles (tellement retouchées que les mannequins en perdent presque toute réalité) le duvet qui court sur les jambes et les bras d'un des mannequin au premier plan de la photo. Helmut Newton devait pressentir cette évolution lui qui, dès 1981 faisait poser le mannequin Violetta Sanchez couchée,
dans une boite en carton avec un peu plus loin son double fabriqué en plastique. Qui est la vraie, qui est la fausse.
Pas de doute à avoir sur les petits films qui sont présentés et qui décryptent de manière lumineuse la manière dont sont mis en scène les défilés de haute couture. Il n'y a rien à voir entre le jeune mannequin gauche et maladroit du premier film de 1923 et les participantes des shows triomphants récents où la scénographie vise à mettre en avant des "modèles" qu'en réalité aucune femme "normale" ne portera.
Retour à la réalité avec la fin de l'exposition et cette série de photographies de jeunes filles saisies au moment même où elles intégraient une école de mannequinat. Au seuil de l'adolescence, elles apparaissent comme très "ordinaires". Et ça fait froid dans le dos car on mesure alors l'écart qu'il y a entre ce qu'elles étaient et ce qu'elles vont devenir.




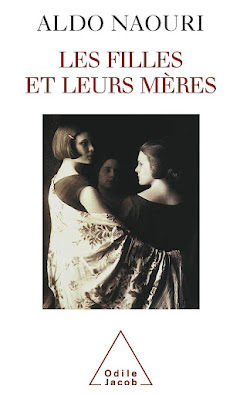






Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire